Sur le bout de la langue S02E14
On parle de France, de Ⓓ, de Ubbak, de cyber-harcèlement et de boule de cristal...
Édito -
Ce lundi 9 juin, le Design Fax n°1368 interviewe une invitée de choix : notre fondatrice Sophie Gay, aux manettes de Namibie.
Elle a rendez-vous – et pas n’importe lequel – avec @Christophe Chaptal pour une conversation pointue sur les langages du branding, les dessous de la création de marques et sa vision de ce métier où le nom juste crée la valeur.
Un décryptage haut de gamme, à retrouver non pas par copie… mais dans le #Design Fax, la référence du design depuis 1995.
Tout nouveau, tout frais -
UBBAK porte plus haut le Réseau Froid de VINCI Energies

À l’origine d’UBBAK se trouvait le réseau froid de VINCI Energies : 20 entreprises & 700 collaborateurs experts du froid, du chaud et du traitement d’air, à qui il manquait une voix unique, forte & distinctive.
L’idée principale ? Le juste équilibre.
Celui d’une expertise entre le froid à -80° & le chaud à + 200°.
Celui d’une quête, vers plus de justesse : technique, financière & environnementale.
Celui d’un combat, contre la sur-production, la sur-consommation & le sur-dimensionnement.
Une promesse incarnée par un nouveau nom UBBAK, inspiré du mot issu de la géologie 𝑢𝑏𝑎𝑐, qui désigne "le versant froid et ombragé d’une montagne ». Un symbole fort reflétant tout autant la double expertise de la marque que ses solutions bas-carbone.
Cette nouvelle plateforme de marque et ce nouveau nom ont ensuite inspiré l’ensemble des codes identitaires, pensés par l’agence : de la signature « Le froid à haut degré » au système graphique, en passant par le ton de voix et les éléments de lancement.
Le froid à haut degré commence ici.
Un grand merci aux équipes VINCI Energies pour leur confiance.
Langue vivante -
Quand le pays devient marque

Si 40% des Français estiment que « personne » ne porte l’histoire nationale, les marques la brandissent là où les institutions manquent à l’appel. 2 Français sur 3 préfèrent une marque qui racontent le pays, tandis qu’à l’international, le label Made in France est gage d’un art de vivre à la française raconté par les grandes maisons et par les productions médiatiques. Les consommateurs semblent conquis mais pour séduire les investisseurs, ce qui paraît une évidence pour le sens commun se doit d’être martelé.
Le 19 mai, les Versaillais accueillaient la 8ème édition du Sommet Choose France. Derrière ce nom qui somme de choisir … la France, un rendez-vous annuel dédié à l’attractivité. Bref, l’Hexagone se fait marque. Le thème cette année ? « France, terre de créativité » : entre tech, agriculture et plus encore, un écho au tourisme après les Jeux Olympiques, au cinéma, à l’aube du festival de Cannes, ou encore à l’architecture, au lendemain de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Bref, la France ne se vend plus comme une simple destination, ni uniquement comme un terrain d’investissements. Elle se mue en marque, se réinvente. Mais derrière ce branding, une question de fond (c’est le cas de le dire) : qu’implique vraiment une « marque France » ?
La vidéo Make it iconic déroule en une minute (chrono en main) ce que le monde entier reconnaît sans effort : un accent à couper au couteau, une tour qui perce les nuages, des points levés en manif’ et un drapeau tricolore. Le tout entrecoupé d’un leitmotiv qui tape du point : « iconic ». Elle structure le discours comme un refrain et agit comme une promesse de reconnaissance immédiate. Cependant, la notion d’icône cristallise une idée ou une identité à travers une relation de ressemblance. Le problème ? Faire d’un pays une suite d’icônes, c’est réduire sa complexité à une poignée de signes et dans le même temps, taire ce qui sort de leurs cadres. L’icône assure l’adhésion, certes, mais tend à simplifier la complexité, à l’esthétiser, et à uniformiser la mémoire collective dans une réalité mouvante.
Qu’on veuille l’admettre ou non mettre un pays en récit, c’est toujours le figer. En choisissant des mots, des images, des icônes. Et si ce branding à grande échelle capte l’attention - les 40,8 milliards d’euros investis grâce au sommet cette année sont la preuve que c’est le cas - , il interroge aussi. Que devient la part de dissonance et de débat, si constitutive de l’identité française ?
En définitive, la transformation d’un pays en marque soulève autant d’opportunités que de tensions. Choose France est une réponse à un monde globalisé, mais aussi, peut-être, à une société fragmentée.
Coup de foudre -
Fête de la musique is the new Coachella

Si Choose France développe de gros moyens pour faire rayonner le pays à l’international, c’est pour tout autre chose, et pour le moins inattendu, que l’on entend parler de la France ces dernières semaines : la Fête de la musique.
Le hashtag #fetedelamusique2025 dépasse les 70 millions de vues, des influenceurs britanniques annoncent un “British coach convoy” direction Gare du Nord sur X, les vlogs de préparation et autres lookbooks façon festival se multiplient sur TikTok. Le constat est sans appel : notre bonne vieille Fête de la musique est devenue un phénomène viral.
Alors forcément, les marques, bars, restaurants et enseignes s’adaptent à grande vitesse. Ce regain d’attention est une aubaine économique pour ces commerçants qui transforment leur terrasse en scènes de DJ sets, certains mettent en place des activations express comme celle de Radio France, qui s’associe à TikTok pour proposer une immersion live dans les coulisses de sa soirée Swing au Studio 104 - montée spécialement pour l’occasion. En quelques heures, ces lieux parisiens se métamorphosent pour capter une audience en quête de cette authenticité joyeuse vendue par les algorithmes.
Attention donc à préserver l’authenticité et l’ADN du moment : une célébration simple, populaire, née dans la rue, portée par l’envie de jouer, de chanter & de rassembler. Veillons à ne pas tomber dans une représentation trop chiante chiadée.
Il s’en est passé des choses -
Spectacle et boule de cristal
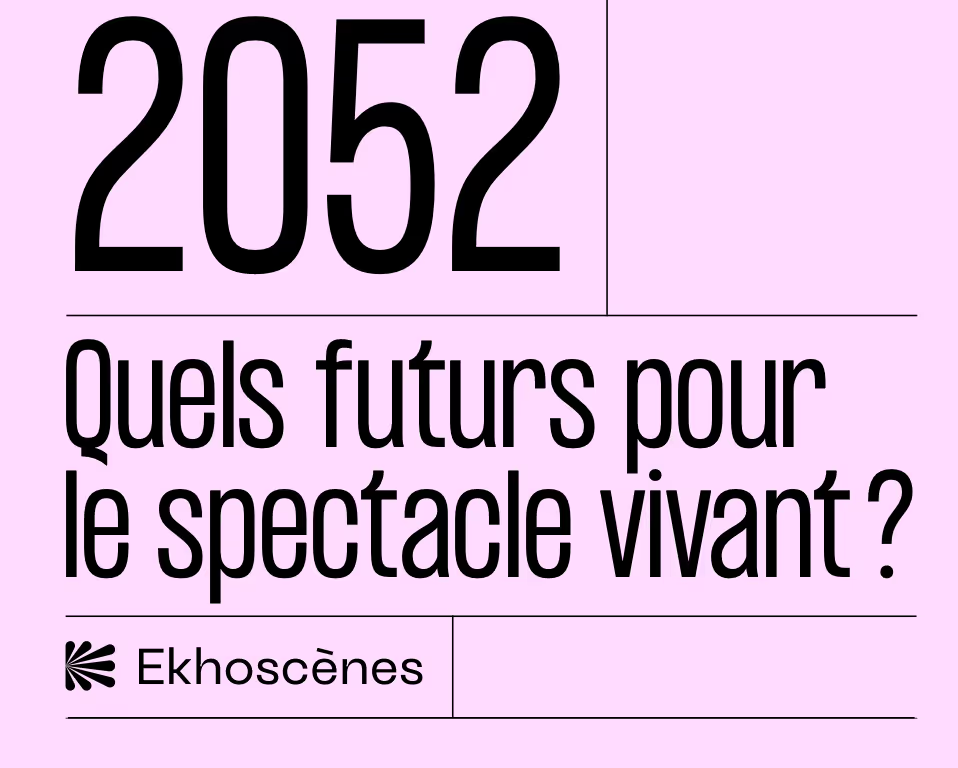
« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »- Peter Drucker.
Anticiper l’avenir en lui donnant vie, c’est justement la tâche à laquelle s’est attelé Ekhoscènes - le syndicat national du spectacle vivant privé -, le 12 juin dernier. Le constat est clair : face aux mutations et incertitudes contemporaines, le secteur culturel ne peut plus penser son avenir à court terme. Ainsi, la deuxième édition des Ekhos, dispositif de médiation mis en place dans ce cadre, étend les horizons jusqu’en 2052.
Le résultat ? Des pistes de réflexions pensées sur la base du recensement de signaux faibles et quatre scénarios offrant d’explorer l’avenir du spectacle vivant - et dans le même temps, celui de la civilisation. Allant encore plus loin, quatre capsules audio ont été créées, chacune s’appuyant sur un scénario. On pressent un vague écho (sans mauvais jeu de mot) à Black Mirror. Immersion sensorielle, vocalisation de futurs possibles : en somme, des alertes ouvrant à l’imagination et … au débat.
Alors, quelles places pour l’artiste et pour son engagement dans ce monde en transition ? Comment continuer à incarner l’innovation quand les exigences économiques somment de se mouvoir à la culture mainstream pour se faire entendre ? Enfin, comment la culture peut-elle devenir un levier pour accompagner les changements ? Les débats sont ouverts, à suivre juste ici.
Voyez qui D-barque
Une petite lettre, un grand symbole : depuis le 1er mai 2025, les designers disposent enfin de leur équivalent du ® ou du © : le Ⓓ.
Tantôt noyée parmi les images, parfois même rendue accessible par des outils automatisés tels que Canva, le design est légion. L’ombre au tableau ? Cette banalisation pousse à l’anesthétisation, à une récupération presque marchande. Le beau devient objet de consommation. Le sens initial se perd et l’intention s’efface, laissant régner la forme.
Cette lettre additionnelle sonne donc comme un rappel : si le design est invisible, car omniprésent, il émane d’un savoir-faire qui ne peut être simulé qu’en surface, dans un contexte où l’IA générative produit des visuels lisses mais dénués de sens, où la frontière entre amateurs et professionnels se brouille.
Ainsi, le design dépasse le simple style, par sa valeur stratégique. Ses artisans n’ont pas vocation à embellir le monde, mais bien à le penser, à accompagner son évolution. Couper court à l’ambiguïté qui entoure cette discipline, c’est le pari de cette initiative. A la clé, une affirmation : le design crée de la valeur et mérite donc d’être protégé. Bref, petit Ⓓ, grosse revendication.
Décoder le langage du cyber-harcèlement

À tous les plus de 30 ans, allez, 40 qui nous lisent : non l’emoji vernis à ongles ne désigne pas seulement une jolie manucure, la pastille violette pas seulement un beau mauve et KYS ne signifie malheureusement pas que l’on vous embrasse. Coup dur, mais vous n’êtes pas seuls. Selon l’IFOP, 75 % des adultes pensent comprendre le langage emoji/SMS utilisé par les jeunes alors que seuls 1,3 % parviennent à déchiffrer correctement six messages type.
Vous nous direz, le langage a toujours été le terrain de moultes incompréhensions entre générations, mais aujourd’hui, le langage se fait plus violent, plus menaçant dans un environnement numérique de plus en plus complexe contribuant insidieusement à une hausse du cyber-harcèlement, pour rappel : 1 élève sur 6 victime de cyber-harcèlement en France.
Alors, pour décoder ce nouveau langage et y déceler les potentiels signes de cyber-harcèlement, Allianz lance une campagne de prévention accompagnée d’une plateforme dédiée proposant un glossaire complet à consulter ici. Une manière de rappeler que la prévention commence par l’échange et que l’échange, lui, commence par parler le même langage.




